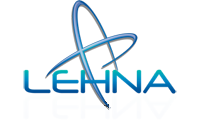DOUADY Christophe J. PU- IUF
Enseignant chercheur : E3S
Université Lyon 1
CNRS, UMR 5023 - LEHNA,
Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés
3, rue Raphaël Dubois - Bât. Darwin C
F-69622 Villeurbanne Cedex France
06 14 98 33 44
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- Les reconstructions phylogénétiques constituent à la fois un champ disciplinaire en constante (r)évolution et un outil méthodologique dont les applications, déjà très variées, ne demandent qu'à être développées. Globalement, ce sont ces aspects qui caractérisent mon activité de recherche.
Contribution à la classification phylogénétique du vivant. Cette première thématique de recherche correspond à la reconstruction des liens de parenté entre organismes. Bien qu’ayant eu l’occasion de développer ces approches sur de nombreux organismes (Arbre du vivant, Gorgones, Chondrichtyens, Roses, Angiospermes aquatiques, Pancrustacés…), j’ai principalement contribué à éclaircir les relations de parenté entre ordres, familles et espèces de mammifères. Cette ligne de recherche nous a permis de révéler l'existence de 4 groupes majeurs de mammifères placentaires. Il est à noter que ces résultats ont profondément révolutionné notre compréhension des relations de parenté inter-ordinales de mammifères placentaires et ont permis de fournir un cadre évolutif robuste qui a largement été repris par la communauté scientifique dans son ensemble. En outre ces analyses nous ont également permis de montrer l'existence de deux groupes majeurs de mammifères insectivores (eulipotyphla et afrosoricida) très éloignés d'un point de vue phylogénétique et l'étroite relation de parenté entre hérissons et musaraignes. Ces travaux ont également permis de réinterpréter la voie de colonisation utilisée par les macroscélidés pour peupler l'Atlas ou d'établir par exemple que le cerf d'Irlande (Megaloceros giganteus) était en fait un daim et Equus hydruntinus, une hémione. Aujourd’hui je cherche principalement à élucider les relations de parenté au sein d’une superfamille d’Isopode (Malacostracé ; Pancrustacé) : les Aselloidea. C’est principalement au travers de ce groupe, et dans une moindre mesure du groupe des foraminifères planctoniques, que je développe les activités décrites ci-après
En parallèle de ces travaux de systématique moléculaire sensu stricto, j’ai également contribué à faire émerger de nouvelles pratiques et méthodologies dans le domaine des reconstructions phylogénétiques. Un des résultats le plus important de cette démarche résulte d’un travail effectué en collaboration avec l'université de Montpellier où nous avons montré (1) qu'il existait des incohérences marquées entre deux des méthodes les plus couramment utilisées pour évaluer la fiabilité d'une reconstruction phylogénétique, à savoir les proportions de bootstrap et les probabilités postérieures, (2) que la corrélation extrêmement variable entre ces deux indices était fortement améliorée si les probabilités postérieures étaient elles-mêmessoumises à une procédure de ré-échantillonnage et (3) que les indices de bootstrap étant plus conservatifs, ils étaient moins enclins à supporter des hypothèses phylogénétiquement incohérentes. Dans un tout autre domaine et en collaboration avec le laboratoire BBE de Lyon, nous avons développé une méthode simple et pragmatique permettant de délimiter les espèces sur la base d’une phylogénie moléculaire. Cette méthode est basée sur l'étroite relation existant, au moins chez les malacostracés, entre divergence moléculaire et diversification morphologique. Dans cette même ligne de recherche, je me suis intéressé aux conditions d’utilisation de taxons chimériques (un taxon étant représenté par des séquences provenant de différentes espèces appartenant au dit taxon) dans les reconstructions phylogénétiques, aux difficultés de la polarisation des arbres phylogénétiques, aux différences de signal phylogénétique entre gènes mitochondriaux et nucléaires ou encore aux précautions nécessaires pour éviter que les données mitochondriales ne soient polluées par des copies nucléaires (Numt).
Structuration spatiale de la biodiversité et diversité cryptique. Cette seconde thématique de recherche correspond, elle, à une interface entre phylogéographie et taxinomie-a. Parce que la phylogéographie a pour objet l’étude des processus ayant présidés à la structuration géographique des lignées généalogiques au sein d’une même espèce ou entre espèces sœurs, cette discipline a très largement contribué à notre compréhension de l’incidence des changements globaux sur la distribution de la biodiversité. Les travaux que j’ai menés ou dirigés ont plus spécifiquement visé à comprendre l’effet des oscillations climatiques du pléistocène (dernier 1,8 million d’année) sur la structuration géographique de la biodiversité européenne. Ainsi, nous avons pu montrer l’existence de refuges continentaux en marge des zones englacées qui auraient largement contribué aux processus de recolonisation de l’Europe du Nord. Nous avons également pu montrer qu’indépendamment du caractère extrêmement fragmenté des milieux aquatiques souterrains, les organismes qui leur étaient inféodés possédaient des histoires extrêmement dynamiques. De plus et par le couplage avec des données d’occurrence et de génétique des populations ou l’utilisation d’inférences bayésiennes couplées à des modèles de diffusion spatiale il nous a été possible de quantifier ces dynamiques et de les placer dans un cadre temporel.
Une conséquence inattendue, au moins dans son ampleur, de ces approches a été de montrer la forte prévalence du phénomène de cryptisme (i.e. existence d’espèces non différentiables sur la base de caractères morphologiques). Ainsi nous avons pu démontrer qu’il constituait un biais majeur aux mesures de biodiversité en milieux souterrains ou en milieux marins. Dans ce dernier cas, la présence d’un tel cryptisme rend discutable voir caduque un grand nombre de fonctions de transfert permettant à partir de données fossiles de déterminer les conditions océanographiques passées. Mes recherches actuelles visent à identifier les conséquences macroécolgiques d’un tel cryptisme ainsi que les mécanismes sous-jacents à la mise en place de ce phénomène.
Reconstruction phylogénétique en écologie et biologie évolutive. L’établissement de la classification phylogénétique du vivant constitue indubitablement une fin en soit. Toutefois, il ne fait également aucun doute que les reconstructions phylogénétiques sont des outils extrêmement pertinents pour aborder nombres de questions en écologie et en évolution. Outre la possibilité que nous offre les phylogénies de détecter les espèces cryptiques, l’analyse phylogénétique des transferts horizontaux de gènes et de leur impact sur la structuration des génomes ou l’émergence des grands groupes de procaryotes constitue une autre application des phylogénies que j’ai explorée. Une application particulièrement importante est l’utilisation de phylogénies pour prendre en compte la non indépendance des données. En effet et alors que la plupart des analyses statistiques telles que les analyses de régression assument que les comparaisons sont indépendantes, les relations de parenté entre organismes induisent une dépendance. Ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressé à l’utilisation des phylogénies pour contrôler ces phénomènes d’inertie ou de contraintes phylogénétiques dans les réponses des organismes à leur environnement. Dans un premier temps, je me suis attaché à développer des approches permettant de reconstruire l’histoire évolutive de caractères ou d’étudier leurs réponses physiologiques. Plus récemment, nous avons développé un modèle biologique original permettant d’étudier les modifications écologiques et évolutives induites par un changement drastique des conditions environnementales. L’établissement de ce cadre de référence nous a permis d’étudier l’impact du changement climatique majeur sur les taux de spéciation. Forts de ce cadre, il nous est maintenant possible d’aborder des questions de macro-écologie, de biologie évolutive, de génomique évolutive ou encore de stœchiogénomique ayant toutes en commun la nécessité de reconnaître les parts relatives des processus neutres et adaptatifs.
Collaborations nationales et internationales :Federic Quillévere (Université Lyon 1)Laurent Duret (Université Lyon 1)Emmanuel Douzery (Université de Montpellier)Ludovic Orlando (Copenhagen University)Snebjorn Palsson (University of Iceland)Cene Fisher (University of Ljubljana)Jean Francois Flot (Université Libre de Bruxelles)Raphael Morad (University of Bremen) - Globalement mon activité pédagogique relève d’enseignements en Ecologie et Science de l’évolution et s’organise principalement autour de trois types d’action :
Enseignement présentiel : des sciences de l’évolution à l’écologie moléculaire. Dans les cadres de ces enseignements dits « classiques », j’enseigne actuellement et principalement dans le cadre de la formation en science de l’évolution et en écologie moléculaire.
Concernant les sciences de l’évolution, j’ai tout d’abord mis en place et dirigé entre 2004 et 2011 une UE optionnelle de Licence 3 - Biologie des Organismes et des Populations - intitulée Evolution et phylogénèse. L’objectif en était de dispenser un socle de connaissances indispensables en science de l’évolution et de fournir des compétences pratiques en reconstruction phylogénétique. Depuis 2012 cette UE a elle même évolué en une UE obligatoire intitulée Evolution. Cette UE vise à faire la synthèse des thématiques relevant des sciences de l’évolution qui leur sont enseignées transversalement dans de nombreuses UE de leur parcours. J’assure la responsabilité de cette UE depuis 2012 et j’’anime une équipe pluridisciplinaire alliant des paléontologues à des génomiciens en passant par des zoologistes, des écologues et des biologistes du développement.
Concernant l’enseignement de l’écologie moléculaire, j’interviens principalement dans le cadre d’une UE de Licence 3 de l’Université de Lyon 1 et d’une UE de Master 1 de l’ENS Lyon et de l’Université de Lyon 1. L’objectif de ces enseignements est de faire le pont entre l’enseignement des mécanismes et techniques de biologie moléculaire et les questions biologiques qui peuvent être abordées grâce à ces marqueurs. Le principal challenge de cet enseignement est de démontrer la pertinence de ces outils à un public plus enclin à considérer des organismes in toto.
Enseignement par (et pour) la recherche. La force du système universitaire est d’établir un lien étroit entre recherche et enseignement. Les stages constituant une opportunité unique pour les étudiants de donner un sens tangible à leur études, je me suis largement investi dans l’accueil d’étudiants. Concrètement, cela m’a donné l’occasion d’encadrer 5 étudiants de L3, 7 étudiants de M1, 11 étudiants de M2, 7 doctorants et d’accueillir pour des durées de quelques semaines à plusieurs mois 5 doctorants français ou étrangers. Dans ce domaine, j’ai également pris la responsabilité de l’UE stage pour les étudiants de Master 1 Ecologie.
Toujours dans ce cadre de l’enseignement par et pour la recherche je co-anime la création une UE intitulée Trends in ecological research (Cohabilitation ENS Lyon –UCBL) visant à développer un enseignement de haut niveau réalisé par des leaders scientifiques internationaux autour des points chauds de la recherche en écologie
Savoir pour tous. La diffusion du savoir depuis les laboratoires vers le grand public est également une des missions importantes de notre fonction d’enseignant-chercheur. C’est pourquoi je me suis investi dans la diffusion de notre activité de recherche dans le cadre de modules de l’Université Ouverte et de l’Université Tout Age. Ces deux structures étant respectivement les vitrines de l’enseignement grand public de l’Université Lyon 1 et de l’Université de Lyon 2. - 2025 Mermillod-Blondin, F., Douady, C.J., François, C.M., Hervant, F., Simon, L., 2025 - Environmental organic carbon availability determines metabolic and consumption rates in freshwater isopods. Oikos, e11149, pp.1-12. ⟨10.5281/zenodo.15066238⟩.2024 Jugovic, J., Malek-Hosseini, M.J., Issartel, C., Konecny-Dupré, L., Kuntner, M., [...], Douady C., Malard, F., 2024 - A second species of Stenasellus Dollfus, 1897 (Isopoda, Stenasellidae) from sulfidic groundwater of Iran described using morphological and molecular methods. European Journal of Taxonomy, 968, ⟨10.5852/ejt.2024.968.2733⟩2024 Morard, R., Darling, K., Weiner, A., Hassenrück, C., [...], Escarguel, G., Douady, C.J., [...], Kucera, M., 2024 - The global genetic diversity of planktonic foraminifera reveals the structure of cryptic speciation in plankton. Biological Reviews, 99 (4), pp.1218-1241. ⟨10.1111/brv.13065⟩2024 Saclier, N., Duchemin, L., Konecny-Dupré, L., Grison, P., [...], Lefébure, T., François, C., Issartel C., [...], Douady, C., Malard, F., 2024 - A collaborative backbone resource for comparative studies of subterranean evolution: The World Asellidae database. Molecular Ecology Resources, 24 (1), ⟨10.1111/1755-0998.13882⟩2023 Alonso, L., Pommier, T., Simon, L., Maucourt, F., Doré, J., Dubost, A., Trân Van, V., Minard, G., Valiente Moro, C., Douady, C.J., Moënne-Loccoz, Y., 2023 - Microbiome analysis in Lascaux Cave in relation to black stain alterations of rock surfaces and collembola. Environmental Microbiology Reports, 15:80-91. ⟨10.1111/1758-2229.13133⟩2022 Conart, C., Saclier, N., Foucher, F., Goubert, C., Rius-Bony, A., Paramita, S.N., Moja, S., Thouroude, T., Douady, C.D., Sun, P., Nairaud, B., Saint-Marcoux, D., Bahut, M., Jeauffre, J., Hibrand Saint-Oyant, L., Schuurink, R.C., Magnard, J.L., Boachon, B., Dudareva, N., Baudino, S., Caissard, J.C., 2022 - Duplication and specialization of NUDX1 in Rosaceae led to geraniol production in rose petals. Molecular Biology and Evolution, Oxford University Press (OUP), 39(2) : 651522. ⟨11.1193/molbev/msac112⟩2022 Malard, F., Verdier, H., Konecny-Dupré, L., Eme, D., Douady, C.J., Lefébure T., 2022 - Subterranean species inventory in the molecular era. Karstologia, 79:73-78.2022 Malek-Hosseini, M.J., Jugovic, J., Fatemi, Y., Kuntner, M., Kostanjšek, R., [...], Douady, C.J., Malard, F., 2022 - A new obligate groundwater species of Asellus (Isopoda, Asellidae) from Iran. Subterranean Biology, 2022, 42, pp.97-124. ⟨10.3897/subtbiol.42.79447⟩. ⟨hal-03623375⟩2022 Morard, R., Hassenrück, C., Greco, M., Fernandez-Guerra, A., Rigaud, S., Douady, C.J., Kucera, M., 2022 - Renewal of planktonic foraminifera diversity after the Cretaceous Paleogene mass extinction by benthic colonizers. Nature Communications, 13 (1), pp.7135. ⟨10.1038/s41467-022-34794-5⟩2022 Mouron, S., Eme, D., Bellec, A., Bertrand, M., Mammola, S., Liébault, F., Douady, C.J., Malard, F., 2022 - Unique and shared effects of local and catchment predictors over distribution of hyporheic organisms: does the valley rule the stream?. Ecography, e06099, ⟨10.1111/ecog.06099⟩2021 Gauthier, M., Le Goff, G., Launay, B., Douady, C.J., Datry, T., 2021 - Dispersal limitation by structures is more important than intermittent drying effects for metacommunity dynamics in a highly fragmented river network. Freshwater Science, 40 (2), pp.302 - 315. ⟨10.1086/714376⟩2020 Francois, C.M., Simon, L., Malard, F., Lefébure, T., Douady, C. J., Mermillod‐Blondin, F., 2020 - Trophic selectivity in aquatic isopods increases with the availability of resources. Functional Ecology, 34:1078–1090.2020 Gauthier, M., Konecny-Dupré, L., Nguyen, A., Elbrecht, V., Datry, T., Douady, C.J., Lefébure, T.. 2020 - Enhancing DNA metabarcoding performance and applicability with bait capture enrichment and DNA from conservative ethanol. Molecular Ecology Resources, 20 : 79-86.2020 Gauthier, M., Launay, B., Le Goff, G., Pella, H., Douady, C.J., Datry, T., 2020 - Fragmentation promotes the role of dispersal in determining 10 intermittent headwater stream metacommunities. Freshwater Biology, 65 (12), pp.2169-2185. ⟨10.1111/fwb.13611⟩2020 Malard, F., Grison, P., Duchemin, L., Konecny‐Dupré, L., Lefébure, T., Saclier, N., Eme, D., Martin, C., Callou, C., Douady, C.J. GOTIT: A laboratory application software for optimizing multi‐criteria species‐based research. Methods Ecol Evol., 11:159-167.2020 Saclier, N., Chardon, P., Malard, F., Konecny-Dupré, L., Eme, D., Bellec, A., Breton, V., Duret, L., Lefébure, T., Douady, C.J., 2020 - Bedrock radioactivity influences the rate and spectrum of mutation. eLife, 9:e56830.2019 Alonso, L., Pommier, T., Kaufmann, B., Dubost, A., Chapulliot, D., Doré, J., Douady, C.J., Moënne‐Loccoz, Y., 2019 - Anthropization level of Lascaux Cave microbiome shown by regional‐scale comparisons of pristine and anthropized caves. Molecular Ecology, 28:3383–3394.2018 André, A., Quillévéré, F., Schiebel, R., Morard, R., Howa, H., Meilland, J., Douady, C.J., 2018 - Disconnection between genetic and morphological diversity in the planktonic foraminifer Neogloboquadrina pachyderma from the Indian Sector of the Southern Ocean. Marine Micropaleontology, 144, 14-24.2018 Eme D., Zagmajster M., Delić T., Fišer C., Flot J.-F., Konecny-Dupré L., Pálsson S., Stoch F., Zakšek V., Douady C. J., Malard F., 2018 - Do cryptic species matter in macroecology? Sequencing European groundwater crustaceans yields smaller ranges but does not challenge biodiversity determinants. Ecography, 41: 424–436.2018 Gippet, J.M.W., Piola, F., Rouifed, S., Viricel, M.R., Puijalon, S., Douady, C.J., Kaufmann, B., 2018 - Multiple invasions in urbanized landscapes: interactions between the invasive garden ant Lasius neglectus and Japanese knotweeds (Fallopia spp.). Arthropod-Plant Interactions, 12 : 351–360.2018 Saclier, N., Francois, C.M., Konecny-Dupré, L., Lartillot, N., Guéguen, L., Duret, L., Malard, F., Douady, C.J., Lefébure, T., 2018 - Life History Traits Impact the Nuclear Rate of Substitution but Not the Mitochondrial Rate in Isopods. Molecular Biology and Evolution, 25(12) : 2900-2912.2017 Bouzid, S., Konecny, L., Grolet, O., Douady, C.J., Joly, P., Bouslama, Z., 2017 - Phylogeny, age structure, growth dynamics and colour pattern of the Salamandra algira algira population in the Edough massif, northeastern Algeria. Amphibia-Reptilia, 38 (4), 461 - 471.2017 Lefébure, T., Morvan, C., Malard, F., François, C., Konecny-Dupré, L., Guéguen, L., Weiss-Gayet, M., Seguin-Orlando, A., Ermini L., Der Sarkissian, C., Charrier, N.P., Eme, D., Mermillod-Blondin, F., Duret, L., Vieira, C., Orlando, L., Douady, C., 2017 - Less effective selection leads to larger genomes. Genome Research, 27 : 1016-1028.2017 Malard, F., Capderrey, C., Churcheward, B., Eme, D., Kaufmann, B., Konecny-Dupré, L., Léna, J.P., Liébault, F., Douady, C.J., 2017 - Geomorphic influence on intraspecific genetic differentiation and diversity along hyporheic corridors. Freshwater Biology, 62:1955–1970.2016 Francois, C.M., Duret, L., Simon, L., Mermillod-Blondin, F., Malard, F., Konecny-Dupré, L., Planel, R., Penel, S., J. Douady, C., Lefébure, T., 2016 - No evidence that nitrogen limitation influences the elemental composition of isopod transcriptomes and proteomes. Molecular Biology and Evolution, 33(10) : 2605–2620.2016 François, C.M., Mermillod-Blondin, F., Malard, F., Fourel, F., Lécuyer, C., Douady, C.J., Simon, L., 2016 - Trophic ecology of groundwater species reveals specialization in a low-productivity environment. Functional Ecology, 30 : 262–273.2016 Morard, R., Escarguel, G., Weiner, A.K.M., André, A., Douady, C.J., Wade, C.M., Darling, K.F., Ujiié, Y., Seears, H.A., Quillévéré, F., De Garidel-Thoron, T., De Vargas, C., Kucera, M., 2016 - Nomenclature for the Nameless: A Proposal for an Integrative Molecular Taxonomy of Cryptic Diversity Exemplified by Planktonic Foraminifera. Systematic Biology, 65(5) : 925–940.2016 Weiner, A.K.M., Morard, R., Weinkauf, M.F.G., Darling, K.F., André, A., Quillévéré, F., Ujiie, Y., Douady, C.J., De Vargas, C., Kucera, M., 2016 - Methodology for Single-Cell Genetic Analysis of Planktonic Foraminifera for Studies of Protist Diversity and Evolution. Frontiers in Marine Science, 3(255) : 1-15.2015 Der Sarkissian, C., Vilstrup, J.T., Schubert, M., Seguin-Orlando, A., Eme, D., Weinstock, J., Alberdi, M.T., Martin, F., Lopez, P.M., Prado, J.L., Prieto, A., Douady, C.J., Stafford, T.W., Willerslev, E., Orlando, L., 2015 - Mitochondrial genomes reveal the extinct Hippidion as an outgroup to all living equids. 11 : 1-5.
2015 Morard, R., Darling, K.F., Mahé, F., Audic, S., Ujiie, Y., Weiner, A.K.M., Andre, Seears, H.A., Wade, C.M., Quillévéré, F., Douady, C.J., Escarguel, G., de Garidel-Thoron, T., Siccha, M., Kucera, M., de Vargas, C., 2015 - PFR2 : a curated database of planktonic foraminifera 18S ribosomal DNA as a resource for studies of plankton ecology, biogeography and evolution. Molecular Ecology Resources, 15 : 1472–1485.2014 Andre, A., Quillévéré, F., Morard, R., Ujiie, Y., Escarguel, G., de Vargas, C., de Garidel-Thoron, T., Douady, C.J., 2014 - SSU rDNA Divergence in Planktonic Foraminifera: Molecular Taxonomy and Biogeographic Implications. Plos One, 9(8), e104641 : 1-19.2014 Eme, D., Malard, F., Colson–Proch, C., Jean, P., Calvignac, S., Konecny–Dupré, L., Hervant, F., Douady, C.J., 2014 - Integrating phylogeography, physiology, and habitat modelling to explore species range déterminants. Journal of Biogeography, 41 : 687-699.
2014 Mondy, N., Grossi, V., Cathalan, E., Delbecque, J.P., Mermillod-Blondin, F., Douady, C.J., 2014 - Sterols and steroids in a freshwater crustacean (Proasellus meridianus) : hormonal response to nutritional input. Invertebrate Biology, 133(1) : 99-107.
2013 Andre, A., Weiner, A., Quillévéré, F., Aurahs, R., Morard, R., Douady, C.J., De Garidel-Thoron, T., Escarguel, G., De Vargas, C., Kucera, M., 2013 - The cryptic and the apparent reversed: lack of genetic differentiation within the morphologically diverse plexus of the planktonic foraminifer Globigerinoides sacculifer. Paleobiology, 39(1) : 21–39.2013 Capderrey, C., Kaufmann, B., Jean, P., Malard, F., Konecny-Dupré, L., Lefébure T., Douady, C.J., 2013 - Microsatellite Development and First Population Size Estimates for the Groundwater Isopod Proasellus walteri. PLoS One, 8(9) e76213 : 1-10.
2013 Eme, D., Malard, F., Konecny-Dupré, L., Lefébure, T., Douady, C.J., 2013 - Bayesian phylogeographic inferences reveal contrasting colonization dynamics among European groundwater isopods. Molecular Ecology. 22 : 5685-5699.
2013 Mermillod-Blondin, F., Lefour, C., Lalouette, L., Renault, D., Malard, F., Simon, L., Douady, C.J., 2013 - Thermal tolerance breadths among groundwater crustaceans living in a thermally constant environment. The Journal of Experimental Biology, 216 : 1683-1694.
2013 Morvan, C., Malard, F., Paradis, E., Lefébure, T., Konecny-Dupré, L ., Douady, C.J., 2013 - Timetree of Aselloidea Reveals Species Diversification Dynamics in Groundwater. Systematic Biology, 62(4): 512–522.
2013 Quillévéré, F., Morard, R., Escarguel, G., Douady, C.J., Ujiie, Y., De Garidel-Thoron, T., De Vargas, C., 2013 - Global scale same-specimen morpho-genetic analysis of Truncorotalia truncatulinoides : A perspective on the morphological species concept in planktonic foraminifera. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 391 : 2-12.
2011
Morard R, Quillevere F, Douady CJ, de Vargas C, de Garidel-Thoron T, Escarguel G. 2011. Worldwide genotyping in the planktonic foraminifer Globoconella inflata: implications for life history and paleoceanography. PloS One, 6: e26665. if2014:3,23
Puijalon S, Bouma TJ, Douady CJ, van Groenendael J, Anten NPR, Martel E, Bornette G. 2011. Plant resistance to mechanical stress: evidence of an avoidance-tolerance trade-off. New Phytologist, 191: 1141-1149. IF2014: 7,67.
Calvignac S, Konecny L, Malard F, Douady CJ. 2011. Preventing the pollution of mitochondrial datasets with nuclear mitochondrial paralogs (numts). Mitochondrion, 11: 246-254. IF2014: 3.25.
2010
Statzner B, Douady CJ, Konecny L, Doledec S. 2010. Unravelling phylogenetic relationships among regionally co-existing species: Hydropsyche species (Trichoptera: Hydropsychidae) in the Loire River. Zootaxa: 51-68. IF2014: 0.91.
Colson-Proch C, Morales A, Hervant F, Konecny L, Moulin C, Douady CJ. 2010. First cellular approach of the effects of global warming on groundwater organisms: a study of the HSP70 gene expression. Cell Stress & Chaperones, 15: 259-270. IF2014: 3.16.
2009
Lalouette L, Kaufmann B, Konecny L, Renault D, Douady CJ. 2009. Characterization and PCR multiplexing of 14 new polymorphic microsatellite loci for the invasive subantarctic carabid Merizodus soledadinus (Coleoptera: Carabidae). Conservation Genetics Resources, 1: 455-458. IF2014: 1,17.
Colson-Proch C, Renault D, Gravot A, Douady CJ, Hervant F. 2009. Do current environmental conditions explain physiological and metabolic responses of subterranean crustaceans to cold? Journal of Experimental Biology, 212: 1859-1868 (Corrigendum 213:2354). IF2014: 2.90.
Voituron Y, Barre H, Ramlov H, Douady CJ. 2009. Freeze tolerance evolution among anurans: Frequency and timing of appearance. Cryobiology, 58: 241-247. IF2014: 1,59.
Trontelj P, Douady CJ, Fiser C, Gibert J, Goricki S, Lefebure T, Sket B, Zaksek V. 2009. A molecular test for cryptic diversity in ground water: how large are the ranges of macro-stygobionts? Freshwater Biology, 54: 727-744. IF2014: 2,74.
2008
Orlando L, Calvignac S, Schnebelen C, Douady CJ, Godfrey LR, Hanni C. 2008. DNA from extinct giant lemurs links archaeolemurids to extant indriids. BMC Evolutionary Biology, 8: 121. IF2014: 3.37.
Scalliet G, Piola F, Douady CJ, Rety S, Raymond O, Baudino S, Bordji K, Bendahmane M, Dumas C, Cock JM, et al. 2008. Scent evolution in Chinese roses. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105: 5927-5932. IF2014: 9.67.
Foulquier A, Malard F, Lefebure T, Douady CJ, Gibert J. 2008. The imprint of Quaternary glaciers on the present-day distribution of the obligate groundwater amphipod Niphargus virei (Niphargidae). Journal of Biogeography, 35: 552-564. IF2014: 4.59.
2007
Orlando L, Hanni C, Douady CJ. 2007. Mammoth and Elephant Phylogenetic Relationships: Mammut Americanum, the Missing Outgroup. Evolutionary Bioinformatics, 3: 45-51. IF2014: 1.45.
Lefebure T, Douady CJ, Malard F, Gibert J. 2007. Testing dispersal and cryptic diversity in a widely distributed groundwater amphipod (Niphargus rhenorhodanensis). Molecular Phylogenetics and Evolution, 42: 676-686. IF2014: 3.92.
2006
Lefebure T, Douady CJ, Gouy M, Gibert J. 2006a. Relationship between morphological taxonomy and molecular divergence within Crustacea: Proposal of a molecular threshold to help species delimitation. Molecular Phylogenetics and Evolution, 40: 435-447. IF2014: 3.92.
Hughes S, Hayden TJ, Douady CJ, Tougard C, Germonpre M, Stuart A, Lbova L, Carden RF, Hanni C, Say L. 2006. Molecular phylogeny of the extinct giant deer, Megaloceros giganteus. Molecular Phylogenetics and Evolution, 40: 285-291. IF2014: 3.92.
Orlando L, Mashkour M, Burke A, Douady CJ, Eisenmann V, Hanni C. 2006. Geographic distribution of an extinct equid (Equus hydruntinus : Mammalia, Equidae) revealed by morphological and genetical analyses of fossils. Molecular Ecology, 15: 2083-2093. IF2014: 6,49.
Clay O, Carels N, Douady CJ, Bernardi G. 2006. Density gradient ultracentrifugation and whole genome sequences: fine-tuning the correspondence. Progress in Colloid and Polymer Science. 131: 97-107. IF2014: NA.
Lefebure T, Douady CJ, Gouy M, Trontelj P, Briolay J, Gibert J. 2006. Phylogeography of a subterranean amphipod reveals cryptic diversity and dynamic evolution in extreme environments. Molecular Ecology, 15:1797-1806. IF2014: 6,49.
2005
Wirshing HH, Messing CG, Douady CJ, Reed J, Stanhope MJ, Shivji MS. 2005. Molecular evidence for multiple lineages in the gorgonian family Plexauridae (Anthozoa : Octocorallia). Marine Biology, 147: 497-508. IF2014: 2.39.
Nieberding C, Libois R, Douady CJ, Morand S, Michaux JR. 2005. Phylogeography of a nematode (Heligmosomoides polygyrus) in the western Palearctic region: persistence of northern cryptic populations during ice ages? Molecular Ecology, 14: 765-779. IF2014: 6,49.
2004
Boucher Y, Douady CJ, Sharma AK, Kamekura M, Doolittle WF. 2004. Intragenomic heterogeneity and intergenomic recombination among haloarchaeal rRNA genes. Journal of Bacteriology, 186: 3980-3990. IF2014: 2,81.
Springer MS, Scally M, Madsen O, de Jong WW, Douady CJ, Stanhope MJ. 2004. The use of composite taxa in supermatrices. Molecular Phylogenetics and Evolution, 30: 883-884. IF2014: 3.92.
Douady CJ, Scally M, Springer MS, Stanhope MJ. 2004. "Lipotyphlan" phylogeny based on the growth hormone receptor gene: a reanalysis. Molecular Phylogenetics and Evolution, 30: 778-788. IF2014: 3.92.
2003
Boucher Y, Douady CJ, Papke RT, Walsh DA, Boudreau MER, Nesbo CL, Case RJ, Doolittle WF. 2003. Lateral gene transfer and the origins of prokaryotic groups. Annual Review of Genetics, 37: 283-328. IF2014: 15,72.
Philippe H, Douady CJ. 2003. Horizontal gene transfer and phylogenetics. Current Opinion in Microbiology, 6: 498-505. IF2014: 5,90.
Doolittle WF, Boucher Y, Nesbo CL, Douady CJ, Andersson JO, Roger AJ. 2003. How big is the iceberg of which organellar genes in nuclear genomes are but the tip? Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences, 358: 39-57. IF2014: 5,00.
Papke RT, Douady CJ, Doolittle WF, Rodriguez-Valera F. 2003. Diversity of bacteriorhodopsins in different hypersaline waters from a single Spanish saltern. Environmental Microbiology, 5: 1039-1045. IF2014: 6,20.
Clay O, Douady CJ, Carels N, Hughes S, Bucciarelli G, Bernardi G. 2003. Using analytical ultracentrifugation to study compositional variation in vertebrate genomes. European biophysics journal, 32: 418-426. IF2014: 2.22.
Chapman DD, Abercrombie DL, Douady CJ, Pikitch EK, Stanhope MJ, Shivji MS. 2003. A streamlined, bi-organelle, multiplex PCR approach to species identification: Application to global conservation and trade monitoring of the great white shark, Carcharodon carcharias. Conservation Genetics, 4: 415-425. IF2014: 2,19.
Douady CJ, Douzery EJP. 2003. Molecular estimation of eulipotyphlan divergence times and the evolution of "Insectivora". Molecular Phylogenetics and Evolution, 28: 285-296. IF2014: 3.92.
Douady CJ, Catzeflis F, Raman J, Springer MS, Stanhope MJ. 2003a. The Sahara as a vicariant agent, and the role of Miocene climatic events, in the diversification of the mammalian order Macroscelidea (elephant shrews). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100: 8325-8330. IF2014: 9.67.
Douady CJ, Delsuc F, Boucher Y, Doolittle WF, Douzery EJP. 2003. Comparison of Bayesian and maximum likelihood bootstrap measures of phylogenetic reliability. Molecular Biology and Evolution, 20: 248-254. IF2014: 9,11.
Douady CJ, Catzeflis F, Springer MS, Stanhope MJ. 2003b. Molecular evidence for the monophyly of Tenrecidae: a reply to Asher. Molecular Phylogenetics and Evolution, 26: 331-332. IF2014: 3.92.
Douady CJ, Dosay M, Shivji MS, Stanhope MJ. 2003. Molecular phylogenetic evidence refuting the hypothesis of Batoidea (rays and skates) as derived sharks. Molecular Phylogenetics and Evolution, 26: 215-221. IF2014: 3.92.
2002
Douady CJ, Chatelier PI, Madsen O, de Jong WW, Catzeflis F, Springer MS, Stanhope MJ. 2002. Molecular phylogenetic evidence confirming the Eulipotyphla concept and in support of hedgehogs as the sister group to shrews. Molecular Phylogenetics and Evolution, 25: 200-209. IF2014: 3.92.
Douady CJ, Catzeflis F, Kao DJ, Springer MS, Stanhope MJ. 2002. Molecular evidence for the monophyly of tenrecidae (mammalia) and the timing of the colonization of Madagascar by Malagasy tenrecs. Molecular Phylogenetics and Evolution, 22: 357-363. IF2014: 3.92.
2001
Scally M, Madsen O, Douady CJ, de Jong WW, Stanhope MJ & Springer MS 2001. Molecular evidence for the major clades of placental mammals. Journal of Mammalian Evolution, 8: 239-277. IF2014: 2,36.
Murphy WJ, Eizirik E, O'Brien SJ, Madsen O, Scally M, Douady CJ, Teeling E, Ryder OA, Stanhope MJ, de Jong WW, et al. 2001. Resolution of the early placental mammal radiation using Bayesian phylogenetics. Science, 294: 2348-2351. IF2014: 33,61.
Clay O, Carels N, Douady C, Macaya G, Bernardi G. 2001. Compositional heterogeneity within and among isochores in mammalian genomes - I. CsCl and sequence analyses. Gene, 276: 15-24. IF2014: 2.14.
Brown JR, Douady CJ, Italia MJ, Marshall WE, Stanhope MJ. 2001. Universal trees based on large combined protein sequence data sets. Nature Genetics, 28: 281-285. IF2014: 29,35.
Springer, M. S., DeBry, R. W., Douady, C. J., Amrine, H. M., Madsen, O., de Jong, W. W. & Stanhope, M. J. (2001). Mitochondrial versus nuclear gene sequences in deep level mammalian phylogeny reconstruction. Molecular Biology and Evolution 18: 132-143. IF2014: 9,11.
Madsen O, Scally M, Douady CJ, Kao DJ, DeBry RW, Adkins R, Amrine HM, Stanhope MJ, de Jong WW, Springer MS. 2001. Parallel adaptive radiations in two major clades of placental mammals. Nature, 409: 610-614. IF2014: 41,46.
2000
Douady C, Carels N, Clay O, Catzeflis F, Bernardi G. 2000. Diversity and phylogenetic implications of CsCl profiles from rodent DNAs. Molecular Phylogenetics and Evolution, 17: 219-230. IF2014: 3.92.
1999
Lavergne A, Douady C, Catzeflis FM. 1999. Isolation and characterization of microsatellite loci in Didelphis marsupialis (Marsupialia: Didelphidae). Molecular Ecology, 8: 517-518. IF2014: 6,49. - Chapitres d’ouvrages :
1. Montgelard C, Bentz S, Douady C, Lauquin J, Catzeflis FM. 2001. Molecular phylogeny of the sciurognath rodent families Gliridae, Anomaluridae and Pedetidae - Morphological and paleontological implications. In: Deny C, Granjon L, Poulet A editors. African Small Mammals, pp. 293-307. IRD, Paris.
2. Brown JR, Italia MJ, Douady CJ, Stanhope MJ. 2002. Horizontal Gene Transfer and the Universal Tree of Life. In: Syvanen M, Kado CI editors. Horizontal Gene Transfer, 2nd Edition, pp. 305-349. Academic press.
3. Clay O, Carels N, Douady CJ, Bernardi G. 2005. Using Analytical Ultracentrifugation of DNA in CsCl Gradients to Explore Large-Scale Properties of genomes. In: Scott DJ, Harding SE, Rowe AJ editors. Modern Analytical Ultracentrifugation: Techniques and Methods, pp. 104-121. The Royal Society of Chemistry, Cambridge.
4. Douady CJ, Nesbø C L. 2007. Reconstructing and interpreting evolutionary relationships. In: Reddy CA editor. Methods for General and Molecular Microbiology, pp 856-868. American Society for Microbiology.
5. Springer MS, Murphy WJ, Eizirik E, Madsen O, Scally M, Douady CJ, Teeling E, Stanhope, MJ, de Jong WW, O’Brien S. 2007. A Molecular Classification for the Living Orders of Placental Mammals and the Phylogenetic Placement of Primates. In Ravosa M, Dagosto M, editors. Primate Origins and Adaptations, pp 1-28. Springer.
6. Douady CJ, Douzery EJP. 2009. Eulipotyphla. In Hedges B, Kumar S editors. Timetree of Life, pp. 495-498, Oxford University Press.
7. Douzery EJP, Blanquart S, Criscuolo A, Delsuc F, Douady C, Lartillot N, Philippe H, Ranwez V. 2010. Phylogénie moléculaire. In Thomas F, Lefevre T, Raymond M editors. Biologie Evolutive, pp 183-243, de Boeck.
8. Douady CJ et DuBow M. 2015. Biodiversité sous pression (cord.). in Empreinte du vivant. Joly D, Faure D, Salamitou S. (dir.) Cherche midi, 132-149.
Résumés et actes de congrès :
1. Irlbeck D, Stanhope MJ, Douady C, Amrine HM, Melby T, McClernon DR, Lanier ER. 2002. Phylogenetic analysis of HIV-1 from an AIDS dementia patient suggests compartmentalized evolution in the mid frontal gyrus of the brain. Antiviral Therapy 7: 65. (résumé).
2. Gibert J, Brancelj A, Camacho A, Castellarini F, De Broyer C, Deharveng L, Dole-Olivier M-J, Douady CJ, Galassi DMP, Malard F, Martin P, Michel G, Sket B, Stoch F, Trontelj P, Valdecasas AG. 2005 Protocols for the ASsessment and Conservation of Aquatic Life in the Subsurface (PASCALIS): overview and main results in World Subterranean Biodiversity. Lyon, France (Proceedings).
3. Lefébure T, Douady CJ, Gouy M, Trontelj P, Briolay J, Gibert J. 2005. Phylogeography and taxonomic status of Niphargus virei (subterranean amphipod). in World Subterranean Biodiversity. Lyon, France (Proceedings)
4. Douady CJ. 2007. Apport des approches moléculaires à la délimitation d'espèces. Bulletin de la Société Zoologique de France 132(4): 281-292.
Articles de Vulgarisation et divers :
1. Lefébure T, Douady CJ, Gibert J. 2005. La phylogénie moléculaire de l'amphipode souterrain Niphargus virei nous révèle une histoire bien cachée. Echokarst 60: 6-7.
2. Malard F, Lefébure T, Issartel J, Douady C, Lazzarotto J, Vodinh J. 2006. De l'influence des glaciations du Quaternaire sur les populations d´organismes aquatiques souterrains. Nature et Patrimoine en Pays de Savoie 18: 26-29.
3. Duret L, Aigle M, Biemont C, Douady C, Escarguel G, Guinet D, Mazin J-M. 2007 Evolution. Les carnets scientifiques. Université Claude Bernard Lyon 1.
4. Douady CJ, Malard F. 2014. De l’approche naturaliste à la compréhention des mécanismes contrôlant la biodiversité : l’exemple des Aselloides. In Jura Patrimoine, les passion de Robert Le Pennec. 87-96.
5. Malard F, Henry JP, Douady CJ. 2014. The scientific contribution of Guy Magniez (1935-2014). Subterranean Biology 13: 55–64